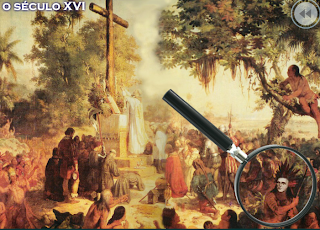Je dédie ce billet à Fleur, que je remercie de nous avoir présenté
Scalar et transmis l'expérience qu'elle en a. Sa démonstration lundi
dernier m'a donné très envie de m'y plonger sérieusement : je n'ai pas
encore eu le courage de mettre les mains dans le cambouis, mais j'ai
séjourné de longues heures dans le "
Users' Guide"
(très bien fait, sous forme de "paths" qui donne d'ailleurs un aperçu
de ce qu'on peut faire avec Scalar, même si la version longue demande du
temps...). Je vous livre les quelques réflexions que manuel m'a
inspirées, et les quelques pistes qu'il me semble intéressant d'explorer
pour donner corps à nos
visual narratives :
Choix du modèle narratif : récit ou itinéraire ?
La notion de "path"
est très intéressante pour la construction du récit historique :
désigne un groupe de pages, un peu comme le chapitre d'un livre, mais en
plus souple et plus flexible. On peut tracer des "intersections paths"
: sorte de chemins de traverse et des croisements entre les pages et
les chapitres, qui autorisent une lecture plus libre - un itinéraire en
somme. La fonction "visualization path" offre une visualisation alternative, sous forme d'arborescence,
qui met en évidence les liens entre les contenus (textes, médias). Mais
le "path" reste plutôt hiérarchique, impose un ordre et une direction :
on est à mi-chemin entre le récit qui impose sa logique et l'itinéraire
totalement libre finalement. La fonction "tag" est une
autre manière de lier les pages et les contenus entre eux, moins
hiérarchique, plus souple. Les tags et liens entre les tags peuvent être
visualisés sous forme de diagramme. L'intérêt est également que les tags ne sont pas nécessairement des mots : on peut créer des tags "non verbaux", à partir d'une image, d'un son, d'un media de manière générale, ou même d'une page entière.
 |
| La fonction "visualization path" offre une
visualisation alternative, sous forme d'arborescence, qui met en
évidence les liens entre les contenus (textes, médias). Mais le "path"
reste plutôt hiérarchique, impose un ordre et une direction : on est à
mi-chemin entre le récit qui impose sa logique et l'itinéraire
totalement libre finalement |
Relations internes entre tout/parties du discours
La force de Scalar à mon avis réside dans le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple e-publication,
servant à transposer ou adapter en format digital un texte
préalablement écrit pour un support papier. Il y a derrière une réelle
réflexion sur la structure du discours et les implications d'un
changement du support sur la forme et le contenu du discours. Le "livre"
Scalar (bien mal nommé à mon avis...) n'est pas qu'une collection ou une suite de pages et de contenus : mais une "modélisation". L'outil semble autoriser une mise en relation "non verbale"
entre les pages et les contenus - une argumentation "immédiate", qui se
passerait des mots ? Par exemple, on pourrait tisser des liens directs
entre des personnages, des événements, des lieux, des sources
historiques, ces relations "immédiates" faisant émerger une hypothèse ou
une question historique (ça reste à éprouver...). On peut ensuite bien
sûr ajouter autant de texte ou d'images qu'on veut, pour expliciter ou
illustrer la démonstration, mais l'ossature de la démonstration reste
non verbale. Deux types de mises en relations sont possibles :
- "whole-whole"
: lien entre des pages ou des ensembles cohérents : liés par les
"paths" (qui restent linéaires et hiérarchiques), les "tags" (non
linéaires et non hiérarchiques) ou les "comments" des lecteurs (qui
rendrait possible une "co-écriture" du récit historique ?)
- "whole-part"
: liens entre des fragments de textes ou de médias et l'ensemble :
passe par les annotations, les "media link", les notes, ou les "Scalar
links"
Relations texte(s)/image(s)
Je renvoie plus précisément à la section "
Page view".
Le
choix de "l'apparence" de la page est fondamental. Il ne s'agit pas
seulement d'apparence justement, d'une simple question d'esthétique :
c'est la structure du récit et les relations textes-images qui sont en
jeu. Deux grandes catégories de "page-view" et de donc de relations textes-images se dégagent :
1) Un modèle plutôt "text-driven" - guidée par le texte, où la logique reste textuelle ou verbale :
- "Text emphasis view"
: deux colonnes déséquilibrés, où le texte occupe la colonne la plus
large, et donc "écrase" les images) - reste très "classique", peu
intéressant pour nous...
- "Split view"
(ce qu'a choisi Fleur je crois) : une disposition en deux colonnes
équilibrées, qui cherche donc une certaine "égalisation des conditions"
entre le textuel et le visuel :
 |
| "Split view" : une disposition en deux
colonnes équilibrées, qui cherche donc une certaine "égalisation des
conditions" entre le textuel et le visuel |
- "Media/paragraphe"
: utile si l'on a un media (image-source) par paragraphe ou un
paragraphe à écrire par media : le risque est de tomber dans
l'illustration, mais peut être exploité aussi pour expérimenter un
discours historique qui serait écrit directement à partir des images
(surtout la fonction "media above"), plutôt que préconstruit
autrement avant d'être plaqué sur les images ? Mais une argumentation ne
repose jamais sur une seule image ou une seule source : pour la
confrontation des sources, ce schéma a des limites.
 |
| "Media/paragraphe" : utile si l'on a un media
(image-source) par paragraphe ou un paragraphe à écrire par media : le
risque est de tomber dans l'illustration, mais peut être exploité aussi
pour expérimenter un discours historique qui serait écrit directement à
partir des images (surtout la fonction "media above"), plutôt
que préconstruit autrement avant d'être plaqué sur les images ? Mais une
argumentation ne repose jamais sur une seule image ou une seule source :
pour la confrontation des sources, ce schéma a des limites. |
- "Media emphasis" : met l'accent sur les media : pourrait servir de support pour expérimenter un authentique "visual narrative" ? Toutefois, le texte garde une place importante. La logique "logocentrique" est maintenue.
 |
| "Media emphasis view" : met l'accent sur les
media : pourrait servir de support pour expérimenter un authentique
"visual narrative" ? Toutefois, le texte garde une place importante. La
logique "logocentrique" est maintenue. |
NB la fonction "annotation" et "annotation path" pourrait aussi remplir cette mission : chaque annotation constitue une page en soi, et l'on peut créer des "paths"
exclusivement constitués d'annotations. Autre possibilité : un récit
entièrement visuel ou presque, construit directement à partir des
images-sources avec la fonction "Media Path" (cf. infra).
2) Un modèle plutôt "visual-driven" ou même "structure-driven" : je renvoie aux différents
modèles de visualisation
de la structure du "livre" qui sont proposés. Ici, ce sont moins les
contenus (textes, images, films...) qui priment, mais plutôt la
réflexion sur le discours et sa structure. C'est adapté pour porter une
réflexion historiographique, pour spéculer sur l'écriture de façon
abstraite, mais à mon avis on évacue par là la Chine et la "chair
historique" du récit... Plusieurs visualisations sont possibles, qui ont
chacune leur spécificités :
- Radial visualization
(sous forme circulaire) : pour valoriser les liens entre pages et
média, permet d'isoler des éléments de contenus mais aussi de les
regrouper par catégories (avec une couleur différente pour chaque
"catégorie" : page, path, annotations, "people"...).
Les contenus sont cliquables et accessibles par un clic. Il y a donc
navigation entre structure et contenu, entre réflexion historiographique
abstraite, et contenu historique concret).
 |
| "Radial Visualization" |
- Index visualization (sous forme de "grille" - grid) : de même, les éléments sont "cliquables" :
 |
| "Index Visualization" |
- "Path Visualization" : sous forme d'arborescence (plutôt linéaire et hiérarchique)
- "Media" ou "tag visualization" : sous forme de graph
ou sorte de "Pearl Tree" : plusieurs incertitudes demeurent : à quoi
correspondent les distances, l'épaisseur des liens, le nombre de liens ?
 |
| "Media Visualization" (en haut) et "Tag Visualization" (en bas) |
Une question non négligeable pour finir : peut-on aisément basculer d'un mode de visualisation à un autre, ou bien faut-il recréer une page (et donc entière "réécrire") pour changer de visualisation et de "page view" ?
Une
autre fonctionnalité, plus anecdotique, mais qu'on peut citer : la
fonction "style" qui permet notamment d'associer un "thumbail" à une
page. J'en parle car ici le visuel est purement décoratif, il s'agit
plus d'un gagdet destiné à égayer vos pages (en plus, il n'est pas
encore possible de le voir...)... De même pour les réglages de la
couleur ou de l'image de fond.
L'historien et ses sources
Je fais référence ici à deux questions importantes pour l'historien:
- la nature des sources : Scalar
est un outil précieux pour l'historien qui doit mobiliser et confronter
des sources diverses, de nature variée. La fonction "Media" recouvre à
la fois des images, fixes ou mouvantes (films), des sons, des textes,
des hyperliens... On doit pouvoir ajouter des documents d'archives
primaires, et y donner directement accès.
- les relations sources primaires/discours de l'historien
(métadonnées et récit historique) : comment les citer et renvoyer aux
sources primaires - seul gage de rigueur et de scientificité, ce qui
permet de vérifier et de garantir la "réfutabilité" du discours de
l'historien. La fonction "description" permet d'ajouter une légende
quand un insère un media, les fonctions "Link", "Media link" et "Note"
permettent de citer les références précises, voire donner directement
accès à la source (stocké en général à l'extérieur). Il semblerait qu'on
puisse finalement renvoyer directement à une source stockée sur une
plateforme qui n'a d'accord avec Scalar (Virtual Shanghai ou Virtual
Tianjin ?) - cf. "Importing Other Media Online".
Lorsqu'on insère un media dans une page, on peut choisir sa localisation
précise, ou bien laisser Scalar choisir la localisation du media : on
introduit ainsi une part d'aléatoire dans la construction du récit historique, une sorte d'historiographie algorithmique,
un peu sur le modèle de "l'écriture automatique" chez les
surréalistes... sauf qu'avec Scalar, "l'automatisme" est entièrement
généré par la machine.La fonction "Annotation" est essentielle également pour lier le
discours de l'historien et ses sources : elle permet d'annoter, de
commenter directement des medias et des fragments de medias, y compris
des films qui peuvent être découpés en séquences, auxquelles on peut
renvoyer séparément. On pourrait imaginer par là faire émerger
"spontanément" le récit à partir des images/médias, plutôt que de
plaquer sur l'image un récit préalablement construit à partir d'autres
sources et par d'autres moyens : en effet, chaque annotation constitue
une page en soi, et l'on peut créer des "paths" exclusivement constitués
d'annotations. Autre possibilité : un discours construit directement à
partir des images-sources avec la fonction "Media